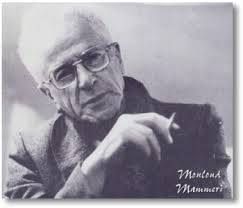
Il est normal que le sommeil de l’algérien suive Le sommeil de la conscience nationale. Très vite, les amalgames t’ont cisaillé, Berbériste, ils ont écrit, crié haut et fort ; En 52, à la parution de La colline oubliée. Un chef d’œuvre de roman nationale, Car à cette époque il fallait « être ou ne pas être », Et tu as été une de nos voix, la voix des bouches bâillonnées Le long de la longue nuit coloniale. Pourtant déjà, dans notre colline emblématique En 45, tu nous parlais des premiers maquis kabyles qui s’organisaient, Et de cette variété de vêtements qui était le signe frappant de la bigarrure des pensées. Mais, en 52 l’idéologie sectaire sévissait et appelait à ton excommunion. Pourtant ce livre a enthousiasmé une grande figure littéraire, entre autres, algérienne et farouche anticoloniale, Kateb Yacine écrira pour te rendre hommage : Ce roman « amour » suffirait à situer son auteur comme un grand écrivain, en Algérie et dans le monde. Ta plus belle réponse à tes détracteurs, a été la parution du « Le Sommeil du juste » Un roman peignant l’atmosphère pré-insurrectionnelle prégnante Illustrée avec cette image parlante d’un de tes personnages Brûlant ses classiques de livres français. Puis à travers « L’opium et le bâton », tu entres en guerre pour la libération nationale, luttant avec fermeté contre tout type d’aliénation, Le plus beau jamais écrit dans ce genre que le cinéma a perverti, usant d’aliénation en changeant les noms des personnages kabyles Akli et Amirouche. Aux lendemains qui déchantent, Tu t’es consacré à épanouir notre culture berbère Arborant des sentiers qui semblais perdus. Tu mérites bien ce titre de chantre de culture berbère. Salués par tous, Bourdieu parlera de ton travail comme d’une odyssée Puis ta conférence sur la poésie kabyle ancienne Fut une fois de plus interdite, la dernière répression Sur ce thème datait de six ans à Constantine Mais cet avril 1980, la Kabylie en un seul bloc Se soulèvera pour défendre une culture longtemps officiellement réprimée. Ton travail en anthropologie nous a appris que l’Algérie est riche De plusieurs mémoires collectives qu’il fallait s’attelait à sortir du déni Pourtant, tu nous alertais dans « Le Banquet », du drame d’un génocide culturel A travers l’exemple aztèque. Je me suis toujours demandée, si tu avais vu venir cette décennie noire que tu n’auras pas connu ; Quand en parcourant avec grand intérêt ton dernier roman « La traversée » J’ai découvert ce personnage intégriste, membre d’une secte religieuse. Oui tu auras été et restera un écrivain algérien de génie, une sommité et de surcroît complet, qui aura parlé dans son œuvre des différents pans de notre histoire… Tant de fois brimée. Tanmirt a Dda Lmulud , Tu as contribué à ce que le cas aztèque ne se reproduise pas chez toi en Algérie Nous te gratifiant d’une infinie reconnaissance. Et qu’il est doux, d’être un 26 février à Ath Yenni, à Taourirt Mimoun et de constater que ta colline veille à ne jamais t’oublier Bien que la télévision nationale n’ait diffusée ton nom que deux fois : Une fois pour t’insulter lors du printemps berbère Et une autre fois pour annoncer laconiquement ton décès. Bien que l’école algérienne veille aussi, à ne jamais te citer. Mais ils auront beau tenter de t’achever une seconde fois, en t’occultant Ils sous-estiment le poids de ce tu nous as légué, Puis, en 2017, nous célébrons ton centenaire. Ton peuple d'abord. L'Algérie officielle suivra:Tamazight accède au statut de langue constitutionnelle. Je vois d'ici ton sourire ravivé. Puis on te consacrera post-mortem.Tes livres seront réédités en tamazight. J'ai même vu l'opium et le bâton passé à la télévision algérienne et Machaho, est carrément passé en tamazight avec des sous-titres. Pour te dire... Bien que je devine ton regard inquiet. Nous mettant en garde contre les risques d'une instrumentalisation d'une culture par l'Etat, c'est à dire sa "folklorisation". Mais tes élèves ont appris la leçon, et la récite parfaitement en poursuivant ton combat, "conscients de la mise à l'écart". Oui, ils sous-estiment réellement le lourd poids, de ce que tu nous as légué. Une richesse inestimable, qu’est : « Cette certitude chevillée que quelque soient les obstacles que l'histoire lui apportera c'est dans le sens de sa libération que mon peuple - et avec lui les autres – ira. L'ignorance, les préjugés, l'inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement. Mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l'on distinguera la vérité de ses faux semblants. » Tout le reste …oui le reste n’est que littérature ! Signé Djermane Amyra
19 Avril 2018
L’expérience vécue et l’expression littéraire en Algérie
Dans des pays comme le nôtre, un individu est confronté à une espèce de choix –pas absolument libre : il lui est aussi imposé –, une sorte d’éventail, un certain nombre de situations entre lesquelles il devra choisir pour s’exprimer.
Dans des pays de vieilles civilisations, de vieux états comme ceux de l’Europe occidentale –parce que c’est ceux que nous connaissons le mieux –, ce genre de problème ne se pose que de façon tout à fait secondaire, pas très déterminante. Il est évident que, quand on passe à l’expérience de pays récemment colonisés, décolonisés et anciennement colonisés, comme l’Algérie, on a l’impression qu’on a là une espèce de passage à la limite, que les problèmes sont plus graves, donc plus clairs, plus faciles à analyser.
Je vais partir d’une constatation banale, très schématique si vous voulez, mais qui peut être prise dans la vie courante. Si nous prenons un Algérien moyen qui travaille à Alger, un berbérophone par exemple, la matinée va se présenter à lui de la façon suivante. Quand il se lève chez lui. Il parle berbère. Quand il sort pour se rendre à son travail, il est dans la rue. Dans la rue, la langue la plus communément employée, c’est l’arabe algérien. Il devra donc connaître ou posséder au moins en partie ce deuxième instrument d’expression. Quand il arrive à son lieu de travail, la langue officielle étant l’arabe classique, il est tout à fait possible qu’il y ait des pièces qui lui arrivent dans cette langue et qu’il va devoir lire. Il lui faudra donc posséder peu ou prou l’usage et l’utilisation de cette langue. Une fois passé ce stade officiel, le travail réel se fait, en général, encore actuellement, en français.
Voilà donc, dans l’espace de quatre heures et peut-être moins, un individu livré à cette espèce de chassé-croisé, de succession d’instruments d’expression qui sont différents les uns des autres et avec lesquels il devra vivre. Entre lesquels il devra quelquefois jouer. Entre lesquels il devra choisir. En tout cas, qu’il soit imposé ou pas, il faudra qu’il ait un usage d’au moins quelques-uns d’entre eux. Il en reste que, si l’on fait l’analyse à un degré un peu plus général, un Algérien moyen a devant lui trois niveaux d’expression, trois niveaux hiérarchisés d’expression. Je vais tâcher de les présenter dans l’ordre hiérarchique décroissant.
Langues d’usage et usages des langues.
Le premier est évidemment l’arabe classique. L’arabe classique, langue littéraire, qui a été décrétée langue officielle, langue nationale et qui est donc la seule légitime administrativement parlant, politiquement parlant. C’est le seul instrument qui soit reconnu. Cependant, ceux d’entre vous qui êtes Algériens le savez très bien, le problème qui se pose dès la base avec ce premier instrument, l’instrument légitime, est le suivant : la langue classique est, pour l’instant du moins, la langue qu’aucun Algérien ne parle. Ce n’est pas l’usage courant de la société algérienne ordinaire. Il n’y a pas d’Algérien qui parle l’arabe classique ordinairement.
Le deuxième instrument, qui vient au deuxième niveau dans la hiérarchie de ces moyens d’expression, c’est le français, séquelle de la colonisation, langue du colonisateur, est demeuré dans l’usage courant et que, par conséquent, il faut aussi le considérer. Celui-là a un statut hybride, un petit peu ambigu. Il n’est, naturellement, pas reconnu. Il est même violemment refusé par l’idéologie officielle. Il était bien évident que le français, d’abord en tant que langue de l’ancien colonisateur, devait être exclu, au moins dans le principe, de la vie algérienne, de la pratique algérienne courante.
Et enfin le troisième et le dernier niveau est celui des langues populaires, des langues qui sont réellement parlées par le peuple algérien. Elles sont, comme vous le savez, au nombre de deux : l’arabe algérien et le berbère. Le statut de celles-là est exactement contraire au statut de l’arabe classique. L’arabe classique est le seul reconnu, le seul officiel mais n’est la langue d’aucun algérien. Les langues populaires, l’arabe populaire et le berbère, sont les langues de tous les Algériens, mais n’ont pas de statut reconnu officiellement. Elles existent réellement sans exister légalement, au sens d’exister constitutionnellement.
Ce tableau est déjà un petit peu général, un petit peu schématique. On pourrait pousser l’analyse plus loin. Mais déjà ce tableau schématique fait apparaître dès l’abord un premier problème, une première contradiction. Entre les deux premières langues, l’arabe classique et le français, qui sont considérées comme des langues nobles, comme des langues dans lesquelles s’expriment toutes les disciplines justement les plus hautes dans la hiérarchie, et les deux langues populaires qui sont d’usage « comme ça », d’usage courant, d’usage ordinaire. Il y a cette contradiction, qui n’existe pas dans d’autres pays, que la langue d’usage courant, n’étant pas reconnue officiellement, ne sert pas non plus à exprimer toutes les disciplines nobles. Elle ne sert pas dans l’administration. Elle ne sert pas pour la littérature, en particulier. Je crois que c’est de cette constatation que l’on pourrait partir.
Les lieux de la langue
On pourrait aggraver en quelque sorte le tableau que je viens de brosser en termes un peu généraux, parce que en réalité, aucun des trois termes précités ne se présente comme un tout monolithique. Chacun d’eux admet encore des subdivisions. Je peux encore, mais très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas la situation –par ce que pour les autres je crois que cela va de soi –, les passer en revue.
En ce qui concerne l’arabe classique, il se présente dans les faits sous deux formes qui sont naturellement très voisines l’une de l’autre : l’arabe classique « classique », celui de la littérature originelle, traditionnelle, telle qu’elle se trouve dans les pays arabophones depuis des siècles, qui était l’arabe traditionnel, et un arabe classique en quelque sorte modernisé. C’est celui qui sert dans la presse par exemple, ou bien dans un certain nombre de documents administratifs. C’est cette langue qui, depuis que Bonaparte a débarqué en Egypte, a été travaillée, mise au point, adaptée à toutes les utilisations modernes que l’on peut en attendre, cette langue, qui est d’abord née dans le Moyen-Orient, en particulier au Liban et un peu plus tard en Egypte et qui a ensuite été transportée dans tous les pays arabophones et qui, actuellement, sert de façon plus fréquente que l’arabe classique traditionnel pour les usages à la fois officiels et littéraires.
Je crois qu’il est important de dire que ce « deuxième » arabe classique en quelque sorte, sert dans ces deux domaines : le domaine de l’administration, le domaine de l’officialité, et le domaine de la littérature, lesquels ne se recouvrent pas nécessairement l’un l’autre.
Il en est de même pour le français. Il y a un certain nombre –on peut parler du français en général bien sûr –mais il y a un certain nombre de domaines privilégiés dans lesquels c’est le français qui est plutôt employé, naturellement employé uniquement dans le fait, il n’est jamais reconnu. Le premier domaine, comme on s’y attendait, c’est dans la technique. Le français est une langue adaptée à la technique moderne, qui la rend très bien, en tout cas beaucoup mieux que les autres langues dont on peut disposer dans un pays comme le nôtre. Par conséquent, pour tous les usages techniques, c’est d’abord le français qui servira. Mais ça ne suffit pas. En réalité, malgré la légitimité unique de l’arabe classique, le français sert dans de très grands domaines de l’administration algérienne, dans l’armée, dans les usines. Enfin, dès que l’on sort du domaine de l’expression purement générale et que l’on entre dans la technique où il faut une compétence, le français intervient.
Mais il n’est pas que là. On sait très bien que dans les villes –pas dans les campagnes, et encore ça dépendrait –il y a une espèce d’usage courant du français. Parce qu’un certain nombre de familles, qui sont plus nombreuses qu’on ne le croit, l’utilisent, comme cela, et que les enfants tout naturellement, parce qu’ils vont à l’école et qu’à l’école au bout d’un certain nombre d’années —la quatrième je crois –ils apprennent le français comme première langue étrangère, le français est de plus en plus employé, et en particulier, encore une fois, dans les villes.
Le troisième usage que le français offre, c’est l’usage littéraire. Celui-là, évidemment, fait un petit peu problème. On s’attendrait à ce qu’un peuple quelconque, une société, un groupement quelconque, s’exprime littérairement d’abord dans la langue qui est la sienne, parce que c’est celle-là qui l’exprime plus profondément. Or, qu’on le veuille ou non, le français, en tant qu’instrument littéraire a été appris comme langue étrangère, comme langue artificielle à un certain moment de la vie de l’individu. Donc, on peut se poser un certain nombre de questions concernant la valeur expressive du français dans des sociétés comme la nôtre.
Comment se fait-il que cette langue qui est toujours stigmatisée comme étant celle du colonisateur, soit plus souvent qu’on ne le croit utilisée à des fins littéraires ? Vous savez très bien qu’il paraît des recueils de poésie en français, des romans, des pièces de théâtre et, curieusement, après l’Indépendance, le mouvement, au lieu de reculer en quelque sorte, est allé plutôt en s’étendant. Pour une raison très simple : pendant la colonisation, le nombre de gens qui avaient vraiment un usage familier du français, qui avaient accès à l’université, était assez restreint. Il n’y avait pas beaucoup d’Algériens qui étaient à l’Université. Je me rappelle avoir été à l’Université d’Alger. Vraiment, nous nous comptions sur le bout des doigts, de mon temps. Actuellement, il y a des dizaines de milliers d’Algériens qui vont à l’Université et comme, pour l’instant du moins, la majorité des cours, sauf en lettres et en droit, sont donnés en français, il est évident que la masse du public susceptible de lire des œuvres écrites en français a plutôt augmenté qu’il n’a diminué. Et c’est pour cela qu’en 1984 il y a plus d’Algériens qui écrivent en français qu’il n’y en avait à la veille de l’indépendance, en 1961. Il y a là donc un problème que nous posons comme cela, quitte à essayer tout à l’heure, avec vous, de trouver un certain nombre de solutions, du moins, d’explications.
Quand on en vient aux langues populaires, il existe aussi un certain nombre de subdivisions qui sont pertinentes dans ce cas-là. L’arabe populaire et le berbère sont, sur le même niveau, diminué, démunis. Mais tout de même, l’arabe algérien a un statut plus toléré que le berbère. Parce que l’arabe algérien est tout de même de l’arabe. Parce que c’est l’instrument de la majorité des Algériens. Parce qu’on considère que, à partir de l’arabe parlé en Algérie, il est plus facile d’accéder à l’utilisation de l’arabe classique parce qu’un certain de mots coïncident.
Le statut le plus évidemment défavorisé, c’est celui du berbère. Celui-là, pendant longtemps, a été tout simplement ignoré. C'est-à-dire que son statut a été l’inexistence. Naturellement, il était toléré dans les faits : il y avait des gens qui parlaient berbère, mais il était reconnu à aucun degré. Je me rappelle, du temps de la colonisation, avoir voulu enseigner cette langue à l’université. Le professeur m’a dit que j’étais trop jeune et puis après plusieurs années, quand je n’étais déjà plus jeune et que le statut politique de l’Algérie avait changé, j’ai refait la même demande et on m’a dit alors que j’étais trop vieux. Je n’ai pas très bien compris à quel moment j’aurais dû enseigner cette langue…
De toute façon, le statut est le suivant : cette langue est considérée comme une espèce de résidu, comme une espèce de séquelle qui n’a jamais servi en tant que langue écrite, en tant que langue de civilisation et qui, par conséquent, n’a pas de statut légitime ou légal. C’est là-dessus que je vais enchaîner pour essayer de poser en termes un peu plus précis le problème. Parce que ce passage à la limite que constitue le berbère va nous servir de comprendre ce qu’il y a en amont. Cette espèce de réalité qu’il y a en aval va servir à rendre un peu plus claires et précises toutes celles dont nous avons parlé tout à l’heure et qui, en réalité, ne sont que des variantes un petit peu émoussées de ce problème.
Le territoire historique du berbère.
Les faits, vous les connaissez, mais je crois qu’un petit rappel historique serait assez bon. Ce statut diminué des langues populaires en face d’une langue de civilisation est, en réalité, un phénomène très ancien dans l’histoire du Maghreb tout entier. Pas seulement de l’Algérie mais aussi de la Tunisie, Du Maroc, de la Libye. En cela, l’arabe populaire n’a fait que continuer le statut qui était celui du berbère avant l’entrée de l’Islam en Afrique du nord. Comment les choses se sont-elles passées dès le départ ?
Vous savez que le Maghreb, par une espèce de malédiction historique, a été dès le début de l’Histoire soumis à une colonisation étrangère : la colonisation phénicienne. Les premiers colons phéniciens sont arrivés au Maghreb douze siècles avant Jésus-Christ ; c’est dire que cela a commencé très tôt. Mais depuis cette colonisation phénicienne, qui était quand même assez superficielle, qui était surtout sut les côtes, depuis cette première colonisation, les dominations étrangères ont été en quelque sorte se succédant sur le sol du Maghreb.
Après les phéniciens sont venus les Romains. Après les Romains, les Vandales. Après les Vandales, les Byzantins. Après les Byzantins, les Arabes. Après les Arabes, les Turcs. Après les Turcs, les Français. C'est-à-dire que, à aucun moment, l’histoire du Maghreb n’a été entièrement déterminée de l’intérieur même du Maghreb. Bien sûr, il faut nuancer, parce que, pour diverses raisons, ces dominations ne sont pas toutes équivalentes. Même si c’est le même phénomène colonial qui se répercute d’une période à l’autre, il y a quand même des différences entre elles.
Mais sur le plan de la culture, puisque c’est lui qui nous occupe en ce moment, quelle a été la conséquence ? C’est que, dès le départ, il y a toujours eu une langue officielle, qui n’était jamais celle du peuple maghrébin, quel qu’il fusse. Déjà du temps des Phéniciens, alors que le Maghreb entier était uniquement berbère, et que, par conséquent, il y avait une unité de peuplement du Maghreb qui a été rompue par la suite, donc à un moment où il y avait une unité réelle des peuplements du Maghreb, la langue officielle même des rois numides, c'est-à-dire des rois berbères (Massinissa, Jugurtha, Mkawsen et tous les autres) était le punique, c'est-à-dire la langue de Carthage. Parce que le punique était une langue répandue dans tout le bassin occidental de la Méditerranée et que, par conséquent, ils avaient intérêt, ou ils étaient contraints, de se servir de cette langue que les autres comprenaient. Les Italiens, avec lesquels ils ont eu maille à partir pendant très longtemps, ne comprenaient pas un mot de berbère mais par contre il y avait d’excellents interprètes de punique parmi les Latins, parmi les Romains.
C’est pour cela qu’à la cour de Massinissa (qui a été vraiment le premier grand roi du Maghreb puisque sa devise était « L’Afrique aux Africains ») la langue des affaire extérieurs était déjà le punique. Et la langue du peuple était naturellement le berbère.
Après les Phéniciens sont venus les Romains. Vous connaissez l’histoire. Les Romains ont délogé le colonialisme punique et l’ont remplacé par le leur qui était infiniment plus lourd, plus minutieux que l’impérialisme phénicien qui était un peu comme ça, superficiel et surtout mercantile. Ils faisaient du commerce, les Phéniciens. C’était du colonialisme quand même mais, malgré tout, beaucoup plus feutré que l’impérialisme romain. Et les Romains sont restés des siècles au Maghreb.
Cette dichotomie qui a existé avec les Phéniciens va se reproduire avec les Romains et de façon peut-être encore plus déterminante, peut-être encore plus grave. A tel point qu’au troisième siècle après Jésus-Christ, l’essentiel de la littérature latine a été écrit par des Berbères. Des Berbères qui étaient Berbères de naissance et qui parlaient berbère chez eux mais qui, dès qu’ils devaient écrire quelque chose, l’écrivaient en latin. Certains sont très connus, d’autres le sont moins. Le plus connu d’entre eux est évidemment Saint Augustin. La mère de saint Augustin, sainte Monique, parlait le latin mais mal ; cependant elle parlait très bien le berbère. Saint Augustin, lui, possédait très bien la langue latine et c’est probablement le plus grand père de l’Eglise pas seulement catholique mais aussi chrétienne. Il n’en demeure pas moins que saint Augustin était contraint en quelque sorte, par les conditions historiques dans lesquelles il vivait, d’écrire dans une langue qui n’était pas la sienne, le latin. Il n’était pas le seul.
Saint Cyprien était berbère, Tertulien était berbère. Arnobe, Lactance, Fronton, Apulée étaient tous des berbères. L’essentiel de la littérature latine à la fin de l’Empire romain a été écrit par des Berbères contraints, encore une fois, par les conditions historiques dans lesquelles ils vivaient, d’employer une langue qui était celle de leurs colonisateurs peut-être, mais qui était le seul instrument universel, à ce moment-là, de communication et de civilisation. Il y avait le grec, mais le grec était plutôt en usage dans la Méditerranée orientale.
Après les Romains sont venus les Vandales qui étaient surtout des guerriers. Ils n’ont fait que passer en Afrique. Ils n’ont pas laissé de grandes traces sur le plan de la culture.
Les Byzantins –le grec était déjà passablement répandu dans le Maghreb –étaient de culture et de langue grecques. Par exemple le roi berbère Juba II écrivait ses œuvres, en particulier d’histoire, en grec. Mais le grec n’était pas demeuré longtemps. Il n’en reste pas moins que la langue officielle pendant la domination byzantine était le grec ou le latin mais pas du tout le berbère.
Avec l’introduction de l’Islam, ce phénomène va se reproduire. La langue officielle est évidemment l’arabe, par-dessus le marché porteur de la religion et de l’idéologie islamique. Par conséquent tous les écrivains qui ont écrit pendant ces siècles-là, ont dû le faire en arabe, que leurs œuvres soient théologiques, historiques, chroniques, juridiques, etc. Et de nouveau le berbère va demeurer la langue du peuple mais coupée de tout usage officiel.
Les Turcs, pour la Tunisie et l’Algérie –pas pour le Maroc qui est resté indépendant –vont avoir un statut un peu ambigu. Ils n’ont pas imposé le turc, mais il n’en reste pas moins que le berbère, de nouveau, reste langue du peuple.
L’espace du colonialisme moderne
Et enfin, le français. L’expérience coloniale française est d’une clarté particulière. Le monde est manichéen. Il est divisé en deux. Il y a une langue –le français –qui est celle du colonisateur et de la civilisation, et l’arabe et le berbère sont relégués dans des emplois tout à fait secondaire et, de toute façon, non reconnus. Ce qui fait qu’on aura la situation suivante renouvelée pendant des siècles au Maghreb : en face d’une culture officielle toujours exprimée dans des langues allogènes, dans des langues étrangères, des cultures populaires qui, d’abord en berbère uniquement puis en berbère et en arabe parlé, sont en réalité coupées de cette langue officielle. Avec toutes les conséquences regrettables que cela peut avoir, parce que toutes les disciplines nobles –les sciences, la philosophie, la pensée abstraite –vont être exprimées uniquement dans ces langues de civilisations, les langues venues de l’extérieur. Du même coup les langues parlées par le peuple maghrébin –algérien pour la circonstance mais, enfin, c’est la même chose pour le Maroc et la Tunisie –vont être cantonnées. On va les mettre en quelque sorte dans des réserves indiennes, dans lesquelles leur statut, leur fonctionnement, leur valeur et leur activité seront limités, contraints, du fait même qu’elles sont dans cet espace insulaire souvent restreint.
Curieusement, il n’y a pas eu cette espèce de mouvement dialectique qui relie l’une des deux expressions à l’autre, que l’on peut trouver dans d’autres langues. Pensez aux grandes langues que vous connaissez : l’anglais, le français, le russe. Ici, il n’y a pas eu ce mouvement par lequel toute la vie qui se concentrait dans les langues populaires aurait pu servir à donner le souffle à la langue littéraire et, inversement, la langue littéraire n’influait pas suffisamment sur les langues populaires pour leur donner tous les instruments dont elles auraient eu besoin pour rendre justement les choses un peu plus relevées, pour rendre le domaine de la pensée ou de la science. On a là une coupure, une coupure dramatique, qui va se prolonger et se répéter pendant des siècles.
Si vous voulez, pour bien faire saisir le processus, on peut décrire la situation telle qu’elle était au moment où les Français, le colonialisme français entre, non pas dans le Maghreb tout entier mais en Algérie puisqu’il a commencé d’abord par l’Algérie avant la Tunisie et le Maroc. Qu’est-ce que les Français ont trouvé devant eux en 1830, quand ils entrent à Alger et dans l’Algérie d’une façon générale ? Ils trouvent un Etat qui est un Etat deylical, un Etat turc, qui est d’administration turque. Et dans le domaine culturel, une vie culturelle toute entière exprimée en arabe classique et représentée par différentes instances : les muftis, les imams, les medrassas, etc., et les deux faisant en quelque sorte un seul corps, l’administration et cette culture classique étant imbriquées l’une dans l’autre. L’administration aidait les écoles. Elle aidait les imams, les muftis, etc. et réciproquement les institutions donnaient un appareil idéologique à l’appareil d’Etat.
En face de ce corps légitime, en quelque sorte, de la société, il y avait l’énorme masse de la société algérienne qui, bien qu’elle s’exprimait en arabe courant et en berbère, était pour l’essentiel coupée de ce genre de chose. Pourquoi ? Parce que l’expression populaire se cantonnait elle-même dans des domaines soit ludiques, soit très circonscrits géographiquement parlant.
Je m’explique. Si un Algérien voulait écrire un traité de philosophie, il n’avait pas le choix. Il apprenait l’arabe classique et il faisait son traité en arabe classique. S’il était un poète inspiré, s’il avait du génie, s’il avait des choses à dire, là aussi il était colonisé parce que, s’il n’avait pas appris cette langue –car ça s’apprend, il faut du temps pour l’apprendre –à l’école, comme c’était le cas de l’écrasante majorité des Algériens, il ne pouvait s’exprimer que dans les deux langues qu’il avait à sa disposition et qui toutes les deux étaient authentiques, étaient réelles, étaient tissées à la vie même du peuple, mais qui quand même n’avaient pas été développées justement par tout l’appareil à la fois d’enseignement, d’écriture, etc., qui sont les instruments normaux d’une culture développée.
Ce qui fait que les Français eux-mêmes ont été pris à cette espèce de jeu, à cette espèce de schéma de la société algérienne qu’ils avaient devant eux. Ils voulaient le pouvoir politique en Algérie et ils ont vu quoi ? Ils ont vu l’administration turque et les corps constitués qui la soutenaient. Le peuple pour eux n’existait que sous une seule forme. Contre le peuple, ils prenaient les armes et le combattait. C’est ce qui s’est passé avec Abdelkader par exemple. Le peuple algérien ne pouvait exister aux yeux des autorités françaises que comme danger possible de guerre, de révolte, d’insurrection, etc., on ne considérait pas que la culture du peuple algérien, la culture agie par le peuple algérien, pût avoir une importance très grande. Alors qu’est-ce qu’on fait les colons ? Ils ont d’abord éradiqué la noblesse, les djouads, la noblesse guerrière.
Une fois qu’ils ont liquidé la noblesse guerrière, ils se sont plus tard attaqués aux instruments culturels officiels, à ceux qui s’exprimaient justement par tous ces corps que je viens de signaler. Et ils en ont eu raison en très peu de temps. Pourquoi ? Parce que ces corps-là dépendaient de l’administration turque, de l’Etat turc, et que, l’Etat ayant disparu, eux-mêmes l’ont suivi dans cette espèce de destruction de la société algérienne de cette époque.
Le lieu de la résistance populaire
Curieusement, la résistance à la colonisation va venir de la littérature populaire. Parce que cette littérature était méprisée, elle était méconnue par le colonisateur. Les colons français considéraient que les quelques poètes dans les marchés en train de taper sur le bendir et de réciter des poèmes étaient sans intérêt. Ils ne leur ont jamais attribué une importance quelconque et c’est pour cela que la vraie résistance à la colonisation, la résistance interne –parce que la résistance externe, la résistance par les armes, a été arrêtée –a été populaire. Le dernier acte a été en 1871 avec Hadj el-Mohand-el-Mokrane mais longtemps après, il a quand même fallu continuer cette emprise sur la société algérienne, et la seule résistance réelle opposée à la colonisation a été celle de la littérature populaire.
Une Algérienne vient de faire une thèse sur la littérature de résistance à la colonisation depuis 1830 jusqu’aux dernières années de la colonisation où elle montre clairement que cette résistance a été continue et efficace. Efficace peut-être parce que cette littérature populaire, qui a été de tout temps condamnée à la clandestinité, a échappé à l’emprise de l’administration et de la police coloniale. On ne considérait pas que c’était très important de voir ce que tel poète pouvait chanter dans un marché ou un café, ou dans une tribu.
De toute façon cette dichotomie entre une culture vécue, qui est la culture vraie, authentique, du peuple, la culture intériorisée, la culture profonde du peuple, et une culture savante, qui est toujours ou presque toujours extérieure et sentie comme telle, est donc demeurée tout au long de notre histoire et s’est simplement montrée de façon plus claire au moment où la colonisation française est intervenue.
L’héritage des centralismes
Dernier acte de cette juxtaposition, ce sont les Indépendances nationales, naturellement. Après les Indépendances acquises –en 1956 pour le Maroc et la Tunisie, en 1962 pour l’Algérie –le statut politique du Maghreb a profondément changé. La colonisation a évidemment disparu. Les conditions sont donc tout à fait différentes. Curieusement, il va se passer là un phénomène que l’on retrouve dans beaucoup d’autres domaines, y compris dans la politique.
Le pouvoir colonial est parti, mais il est resté dans ce pays tellement longtemps –et en Algérie plus d’un siècle, un siècle et un tiers –que, en partant, il n’a pas sombré comme ça, corps et âme, sans que rien n’en reste. Il a laissé un certain nombre d’habitudes, un certain nombre de classements de valeurs que, quelquefois, les nouveaux Etats indépendants du Maghreb ont repris sans toujours s’en rendre compte ou le vouloir.
En particulier, il y a un principe de l’administration française, de la politique française, qui a été repris dans les trois pays, selon des modes un peu différents, mais quand même fondamentalement semblables. Depuis 1789, même avant, depuis Louis XIV peut-être, l’Etat français était un Etat centralisé. Il y avait Paris et autour de Paris, La France, les provinces. La République est une et indivisible, comme le dit je ne sais plus quel article de la constitution française. Il y avait un idéal d’Etat jacobin, que les Français ont non seulement appliqué chez eux, mais qu’ils ont également transporté à travers le reste de l’Europe, avant de venir nous l’apporter à nous, Maghrébins, et en partant ils l’ont laissé dans l’esprit de ceux qui avaient été formé dans leurs écoles et qui, après les avoir combattus, avaient repris le pouvoir, soit en Algérie, soit en Tunisie, soit au Maroc.
Cet idéal de l’Etat jacobin –je ne sais pas s’il faut dire malheureusement –coïncidant avec la conception d’Etat islamique classique, de la grande époque de l’Islam, qui était le Moyen Age, où toute l’umma islamique constituait un seul Etat autour d’un chef qui était le chef des Croyants. Le calife était à Damas, puis plus tard à Bagdad et même au Caire avec les Fatimides. Il y avait là une espèce de conjonction d’une tradition islamique très ancienne et d’une tradition française relativement récente qui, malheureusement allaient dans le même sens, soit dans le sens d’un Etat fortement centralisé autour d’une capitale, autour d’une culture, autour d’une langue, autour d’une seule forme d’expression. C’est pour cela que les Etats indépendants, contrairement à ce à quoi on aurait pu s’attendre, ont reproduit, en quelque sorte, ont reconduit cet idéal d’Etat jacobin que la France nous avait laissé avant de partir, et actuellement, dans les trois pays du Maghreb, l’arabe classique est présenté, est considéré comme la seule langue officielle, légitime, les autres étant encore une fois des espèces d’instruments tolérés mais ne faisant pas partie constitutionnellement de la vie de la nation.
Les lieux d’une expression
A ce point de l’exposé, je voudrais, surtout pour ceux qui ne sont pas Maghrébins, montrer que cette expression populaire, cette littérature populaire était dotée de vertus qui, véritablement, auraient dû être reprises, prises en compte, parce qu’elles offrent un certain nombre de caractères qui justement font son authenticité, sa valeur.
Bon, je vais le faire pour le berbère parc que je connais moins bien l’arabe populaire algérien. Pour parler de littérature populaire arabe il faut être beaucoup plus versé que je le suis moi-même dans ce domaine-là. Je connais mieux, évidemment, la littérature berbère et, si vous voulez bien, c’est de celle- là que je vais parler très brièvement.
Alors je vais vous faire un panorama un peu rapide, mais qui servira peut-être à donner, à faire ressortir un des caractères de cette littérature populaire : à savoir qu’elle est vraiment tissée à la vie du peuple. Elle en sort et elle y retourne. Elle n’est pas coupée de la vie du peuple. Elle fait partie de sa quotidienneté. Elle fait partie de ce qu’il y a de plus profond.
Il se trouve que, pour la Kabylie, on a des documents qui remontent assez loin dans le passé. Donc, on peut présenter un tableau qui soit un peu plus complet. Je me borne à la poésie. Il y a les contes, etc., je n’en parlerai pas, c’est trop long. Je me bornerai au créneau très étroit de la poésie.
Si l’on considère ce créneau-là, on voit que la poésie populaire a servi réellement à rendre plus profond les sentiments du peuple et ses valeurs, ses idéaux, depuis certainement deux à trois siècles. Avec les documents dont on dispose, on peut distinguer trois parties, trois périodes dans l’histoire de cette poésie. Celle qui a précédé la colonisation, celle qui a coïncidé avec la colonisation française et celle qui est postérieur à l’Indépendance.
La poésie antérieure à la colonisation est une poésie de société équilibrée. Depuis déjà quatre ou cinq siècles, la société maghrébine avait atteint une espèce d’équilibre. Je ne sais pas s’il faut parler d’histoire froide, mais en tous cas l’évolution n’avait pas été déterminante depuis la fin du Moyen Age, depuis la fin de la grande civilisation islamique. C’est à peu près la fin des Almohades. Le Maghreb avait accédé à une période au déroulement lent mais équilibré qu’on le veuille ou non, on peut le regretter bien sûr mais c’est un fait.
Alors comment se présente la poésie à ce moment-là ? C’est une poésie uniquement orale, mais très largement suffisante pour servir d’expression au peuple qui s’y reconnaît. D’après les genres et les thèmes de cette poésie, on peut reconstituer la vie tout entière et pas seulement la vie vécue, mais aussi tout son imaginaire, tous ses rêves, tous ses espoirs. Et moi je trouve que c’est vraiment un caractère tout à fait remarquable d’une expression littéraire quelle qu’elle soit.
Quels sont les thèmes les plus généraux de cette poésie-là ? Ce sont surtout les thèmes religieux. C’est une poésie très fidéiste. Les gens sont musulmans, même si la pratique n’est pas très orthodoxe. Ils assument ça, ils veulent ça. Pour le domaine dont je parle en ce moment, je veux vous citer un seul texte, parce qu’il y a tout un côté d’expression mystique qui est très belle à côté de l’expression religieuse un peu plus terre à terre.
Prophète par qui je prélude
Ecoute, prête l’oreille à mon appel
Je ressasse ton éloge
Chaque jour je te rends grâce
Tu es mon repas du soir
Et celui du matin
A l’aube tu es ma nourriture première
Tu es la réserve d’eau bonne pour la soif
Plus douce que toutes les sources
Tu m’es plus doux que beurre fondu
Plus qu’un rayon de miel ou que sucre
Plus que les produits des vergers
Qui pendent mûrs aux arbres
Prophète, fais de moi ton métayer
Le serveur de ton attelage
Me voici à ta porte mendiant
Car qui vient à toi s’en va comblé
Pourvois mon dénuement
Gardien des silos
Fournis-moi jusqu’à satiété d’un bonheur insatiable
Donne-moi la joie pleine, le rire
Dis-moi, tu es libéré !
Dans le texte berbère, ces vers sont très beaux, parce que le poète les sentait : et je suis sûr que les auditeurs qui pouvaient entendre un poème comme ça communiaient avec celui qui l’avait créé.
L’autre thème qui revient souvent dans ces poèmes, c’est la guerre et la société civile. C’était une société très guerrière ; donc c’était un thème qui revenait souvent. Je peux de mémoire seulement vous traduire trois tous petits vers d’un poème. Le poète s’adresse à son auditoire et demande :
Dites-moi quel sera le salut de quelqu’un si le plomb des balles
Ne sauve pas
Prières ni supplications ne le sauveront
Pauvre de toi si tu ne t’armes point pour le combat.
C’était là l’atmosphère dans laquelle cette société vivait.
La colonisation arrive : mutation fondamentale, traumatisme de cette société qui est complètement brisée par le système colonial, qui le sent, bien sûr, mais est incapable d’y répondre. Toutes les instances officielles ont été détruites. Il reste la poésie populaire qui aide le peuple à résister à l’agression.
Le plus grand poète de cette époque s’appelle Si Mohand-ou-Mhand. Ç’a été un génie. Je regrette personnellement qu’il n’ait pas accédé à l’écrit parce qu’il aurait été certainement un des plus grands poètes de l’époque. Je veux dire du monde et pas seulement de notre région. C’était un poète inspiré. Je vous cite un de ses courts sonnets, il parle de la colonisation :
Je jure que de Tizi-Ouzou
Jusqu'au col d'Akfadou
Nul ne me donnera des ordres
Je briserai mais je ne plierai pas
Et plutôt être maudit
Au pays où les chefs sont des entremetteurs
Si l'exil est mon destin
Alors vienne l'exil
Mais pas la loi des pourceaux.
Là aussi, il faudrait entendre les vers dans la langue d’origine, et je regrette de ne pouvoir le faire. Le poète aide le peuple à supporter les inégalités que la colonisation a créées. Le système a créée un corps d’indigènes collaborateurs, entièrement à sa solde, dont il a fait le bonheur bien sûr : il leur a donné des terres, de l’argent, etc. , mais le poète l’exprime bien :
Sidi Bou-Shab
saint au manteau bariolé
entre les hommes fait de justes parts
De l’un le destin est blanc
il regorge de tous biens
et heureuse sont ses amours
Un autre est dans les épreuves
et sa mère chaque matin se demande
où il a bien pu passer cette nuit.
Il y en a comme ça des tas d’autres
Je passe encore une fois et j’en viens à la dernière période, celle d’après l’indépendance. Après l’indépendance, l’instruction s’est étendue. La langue berbère orale tend de plus en plus à devenir langue écrite. Les poètes nouveaux ont de tout autres thèmes d’inspiration que les thèmes traditionnels. Je n’ai pas le temps d’insister là-dessus. Je vais terminer par le poème de l’un d’eux, toujours vivant, qui donnera un peu l’atmosphère de cette poésie :
Dussè-je aller au bout du monde
Et dussent se taire tous les textes
Dussè-je subir les embuscades
Et dût le sang se dessécher
Dussè-je pousser comme méchant bois
Et ne consulter aucun sage
Dût ma poudre être trempée
Et la trace de mes pas se perdre
Dût le soleil d’hiver brûler
Sans personne à réchauffer
Dussè-je oublier la bouillie d’herbe
Et me laisser séduire par les mots
Je n’oublierai pas celle qui m’a engendré
Ni le chant qui m’a bercé.*
In Dérives n°49,1985. Montréal
Scorie:
* Poème de Ben Mohamed, poète kabyle.